
|
Realisateurs
|
 |
|
|
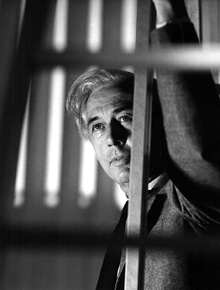 ROBERT BRESSON
ROBERT BRESSON Quand la guerre éclate en 1939, Bresson s’engage dans l’armée. Fait prisonnier en Hollande lors de la défaite de la France en juin 1940, Bresson est rapatrié en mars 1941. De retour à Paris, il réalise un long-métrage, Les Anges du péché (1943), où il s’agit des soeurs de Béthanie, un ordre religieux qui se consacre à la réhabilitation spirituelle et morale de femmes qui sortent de prison. Les dialogues sont écrits par l’auteur dramatique célèbre, Jean Giraudoux.
Encouragé par la réussite de ce premier film, Bresson entreprend d’adapter l’histoire de Mme de la Pommeraye, l’épisode central d’un roman du dix-huitième siècle, Jacques le fataliste et son maître (ca. 1770) de Denis Diderot. Ayant recruté Jean Cocteau pour l’aider à écrire les dialogues, Bresson réalise Les Dames du Bois de Boulogne (1945) dans les conditions matérielles très difficiles de la fin de la guerre et de la Libération. Son film est une version modernisée du récit de Diderot, où une femme du monde se venge de son amant infidèle en lui faisant épouser une fille de mœurs faciles, une “grue”. Les Dames, malgré de grandes qualités qu'on lui reconnaîtra par la suite, est le plus grand “échec” (le seul film non primé) de la carrière de Bresson. De manière générale, les critiques de l’époque sont sévères, trouvant le film trop sec, lent et monotone, les personnages trop désincarnés, trop froids pour communiquer les passions humaines en jeu.
La sortie des Dames est suivie d’une ellipse de cinq ans, pendant laquelle Bresson écrit, seul cette fois, une adaptation du roman de Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne (1936), où il s’agit de l’acheminement vers la grâce, dans la solitude et l’agonie, d’un jeune prêtre dans une petite communauté rurale. Réalisé en 1950, le film du même nom est acclamé comme un chef-d’œuvre indiscutable, obtient de nombreux prix et apporte à Bresson une célébrité internationale.
Après deux projets non-aboutis au début des années cinquante — une adaptation de l’histoire du chevalier Lancelot du Lac, du poète médiéval Chrétien de Troyes, et une autre du célèbre roman classique de Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves (1678) — Bresson découvre en 1954 le récit d’une évasion spectaculaire d’une prison de la Gestapo pendant l’Occupation. L’adaptation au cinéma de cette histoire véritable, sous le titre même du récit, Un condamné à mort s’est échappé, n’est que le quatrième film de Bresson en treize ans, mais celui-ci est déjà devenu une sorte de légende dans le monde du cinéma français. Bresson a ses détracteurs et ses inconditionnels, mais ceux-ci, Janick Arbois par exemple, voient dans cette courte série de films une marche vers “le perfectionnement, l’approfondissement d’une œuvre ‘extraordinaire’ au sens le plus fort du mot”. Arbois ajoute, d’ailleurs, qu’”il n’y a pas de film secondaire dans la carrière cinématographique de Bresson”, ses quatre films étant “autant d’œuvres essentielles d’une richesse inépuisable et que le temps ne démodera pas”.
Après Un condamné, Bresson continuera de réaliser des films jusqu’en 1983. Pickpocket (1959), une adaptation très libre de Crime et Châtiment de Dostoïevsky, est considéré par certains critiques comme le meilleur film de Bresson. Celui-ci sera suivi du Procès de Jeanne d’Arc (1962), puis de Au hasard Balthazar (1965), une fable remarquable sur la vie (et sur le mal) vue à travers les étapes de l’existence d’un âne.
Les films de Bresson deviennent de plus en plus austères et métonymiques du point de vue stylistique. Il interdit à ses acteurs, qu’il appelle ses « modèles », de « jouer » ; il faut qu’ils parlent d’une manière monocorde, pour les dissocier du style théâtral. Bresson préfère souvent des gros plans ou des plans rapprochés de détails qui suggèrent l’action plutôt que de la montrer directement. Comme dans le théâtre classique, la violence n’apparaît que très rarement à l’écran dans les films de Bresson.
Si Bresson évite toujours de filmer la violence, ses derniers films sont de plus en plus pessimistes, mettant en scène souvent la mort, et surtout le suicide. Dans Mouchette (1967), l’adaptation d’une deuxième œuvre de Georges Bernanos, il s’agit du viol et du suicide d’une jeune adolescente. Une femme douce (1969), le premier film en couleur de Bresson, commence par le suicide d’une femme, suivi d’un long flashback où son acte trouve son explication dans l’extrême difficulté de ses rapports avec son mari. Après Quatre nuits d’un rêveur (1971), l’adaptation d’une nouvelle de Dostoïevsky, Lancelot du Lac (1974) propose une vision démythifiée et désabusée des chevaliers de la Table Ronde. Le Diable probablement (1977) commence par la nouvelle du suicide d’un jeune écologiste idéaliste, puis nous raconte son histoire. L’Argent (1983), le dernier film de Bresson, est une oeuvre très dure, sans musique de fond pour atténuer sa sévérité, où Bresson développe la thèse du rapport entre l’argent corrupteur et la violence.
Bresson est mort en 1999.
Filmographie choisie
1934 Public Affairs (Les Affaires publiques, short subject)
1943 Angels of the Streets (Les Anges du péché)
1945 Ladies of the Park (Les Dames du Bois de Boulogne)
1950 Diary of a Country Priest (Journal d’un curé de campagne)
1956 A Man Escaped or The Wind Bloweth Where It Listeth (Un condamné à mort s’est échappé ou Le Vent souffle où il veut)
1959 Pickpocket
1962 Trial of Jeanne d’Arc (Procès de Jeanne d’Arc)
1965 Balthazar (Au hasard Balthazar)
1967 Mouchette
1969 A Gentle Woman (Une Femme douce)
1971 Four Nights of a Dreamer (Quatre nuits d’un rêveur)
1974 Lancelot of the Lake (Lancelot du Lac)
1977 The Devil Probably (Le Diable probablement)
1983 Money (L’Argent)